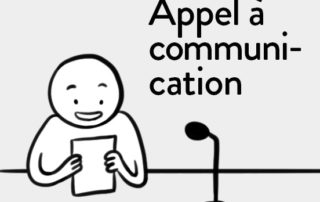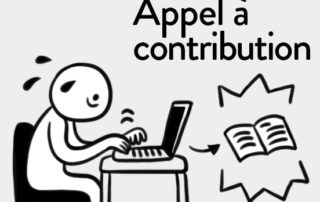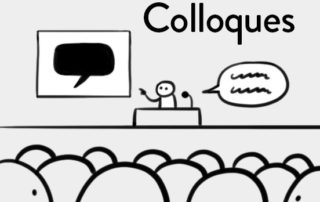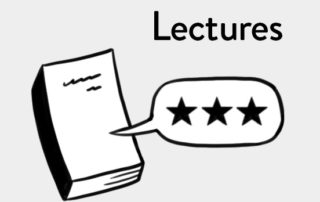Nouvelles représentations de l’Espagne franquiste dans le roman graphique
L'étude de la bande dessinée à l'époque franquiste (1939-1975) a fait l'objet de plusieurs travaux qui ont souligné les enjeux sociaux, doctrinaux et politiques d'un genre particulièrement contrôlé par la censure de par sa capacité à faire passer des critiques dans un style riche en connotations et en déformations graphiques et verbales, souvent par le biais de l'humour. [...] Dans cette journée, nous nous intéresserons principalement aux productions réalisées ces vingt dernières années. Elles montrent un intérêt renouvelé pour l'époque franquiste de différentes façons et avec des intentions bien diverses. Si cette époque a été moins traitée pendant les années de la Transition, malgré quelques exceptions, à partir des années 1990 et surtout au début du XXIe siècle les nombreux romans graphiques et les nombreuses BD sur la société franquiste témoignent de l'intérêt que les dessinateurs, l'industrie éditoriale et les lecteurs portent à cette époque si longue et marquante. [...]