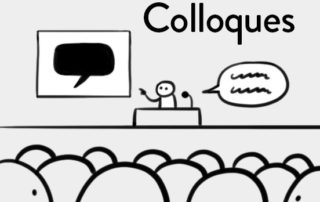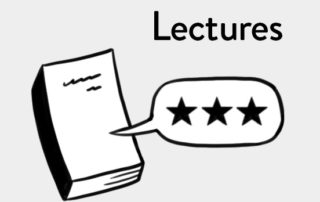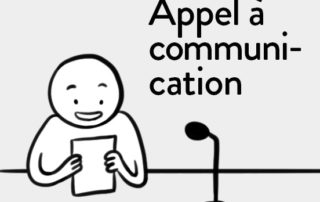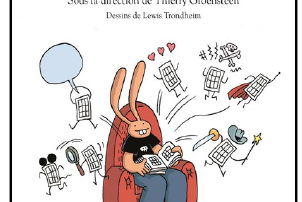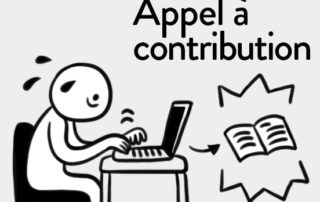Journées des masterant·e·s 2024
La Brèche, association de recherche en bande dessinée, organise le 23 mars 2024 sa troisième journée des masterant·es en partenariat avec la CIBDI. Le but de cet évènement est de permettre à des masterant·es travaillant autour du medium bande dessinée de venir présenter leurs recherches durant une présentation orale suivie d’échanges avec le public. Cette journée permettra aussi de mettre en contact des personnes travaillant autour de la bande dessinée. Les masterant·es qui envisagent de continuer dans le milieu de la recherche auront l’occasion de rencontrer des personnes qui pourront répondre à d’éventuelles questions. Le programme La journée à lieu de 8h30 à 17h à Angoulême au musée de la bande dessinée. 8h30 : accueil café 9h : Alice Lepert – Représenter les émotions du dérèglement climatique en bande dessinée 9h40 : Alexandre Georges – Œuvre et style de Chen Uen 鄭問 : un artiste et auteur taïwanais 10h20 [...]